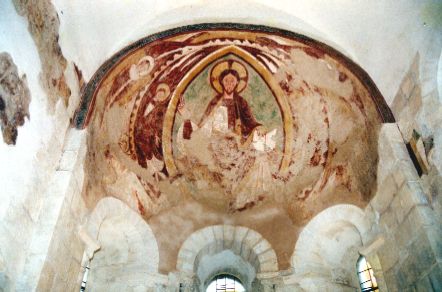LA RESTAURATION DE L'EGLISE ROMANE
La restauration de l'église romane s'échelonna sur trois tranches : 1987-88 et 1989-90 pour les extérieurs, 1995-96 pour l'intérieur.
Le déroulement des travaux de restauration.
(…) la première tranche de travaux, pour un montant de 400 000 francs,
concerna, outre le confortement du pilier sud, la réfection de la charpente
et de la couverture. Le suivi de ces travaux qui s'achevèrent à la fin
de l'année 1987 révéla qu'initialement la toiture médiévale était posée
directement sur la voûte sans charpente intermédiaire, limitant ainsi
les risques d'incendie.

Présentation de l'église.
La structure de l'ensemble de l'édifice restauré date du XIIème siècle.
Elle se compose d'une abside, d'un chœur, d'un avant-chœur et d'une pièce
(l'annexe) communiquant avec l'avant-chœur par une porte. Il faut également
y ajouter un clocher. Mais celui-ci, toujours en activité, n'a pas été
intégré au projet de restauration. Seuls ont disparu la nef et le portail,
ce qui nous prive de la partie plus particulièrement destinée aux fidèles.
(…)
L'ossature générale de l'édifice est constituée de blocs de calcaire Bathonien
d'Ambrault en moyen appareil (hauteur et profondeur trente-deux centimètres
pour une longueur de quarante-six centimètres). Certains portent des layages
obliques et d'autres des layages en chevrons (en forme d'arêtes de poisson).
Les fondations et le reste des parements sont en petit appareil dont la
taille varie autour d'un module de dix centimètres de haut sur quinze
centimètres de long. Les fondations sont maçonnées à pleine fouille, c'est-à-dire
directement au contact des parois des tranchées. Le mortier utilisé pour
les joints et le bourrage interne est semblable à celui du reste de l'élévation.

A l'intérieur de l'édifice, le passage de la fondation à l'élévation est réglé par le niveau du pavement en calcaire blanc. Alors que des carreaux en terre cuite ont été retenus pour la restauration, au XIème siècle le dallage était constitué par des dalles calcaires d'une épaisseur moyenne d'environ cinq centimètres pour une taille variant entre quinze et vingt centimètres de côté.
Les travaux de restauration ont consisté à l'extérieur essentiellement en la réfection complète de la toiture, la reprise des murs, la restitution de la forme des ouvertures et le rétablissement de l'entablement des modillons (ornement placé à la base de la toiture).
A l'intérieur, les réaménagements furent là aussi multiples
:
- dans l'abside, les trois fenêtres ont retrouvé leur forme d'origine.
Elles avaient été retaillées en 1851 quand une boiserie peinte vint recouvrir
l'intérieur de l'abside et du chœur,
- au milieu de l'abside, un autel a été remonté sur les fondations de
celui du XIIème siècle et la cuve du sarcophage qui se trouvait au pied
a été laissée en place simplement recouverte par le sol de carreaux en
terre cuite,
- sur le mur nord du chœur, la hauteur difficilement accessible où se
trouve la crédence (niche à fond plat où l'on place des objets nécessaires
au culte) n'a rien d'étonnant dans la mesure où celle-ci a été mise en
place au XVIIIème siècle, à une époque où le sol de l'édifice était bien
plus haut qu'au XIIème siècle,
- par contre, le lavabo et la crédence sur le mur sud du chœur sont bien
du XIIème siècle,
- dans l'avant-chœur, de part et d'autre de la porte de jonction avec
la pièce annexe, les deux vastes niches ont retrouvé leur volume et leur
forme d'origine,
- en face sur le mur nord, à l'emplacement du trou surmonté de l'inscription
"1648", il faut très vraisemblablement imaginer un aménagement en boiserie
dédié à la famille de Montmorency,
- à la jonction nef/avant-chœur, les travaux de restauration ont fait
disparaître deux niches, côté nef. Ce sont elles dont parle en 1868 l'abbé
Lamy, alors curé de la paroisse, lorsqu'il dit : "les petits autels appliqués
de chaque côté de l'entrée du chœur sur le mur pignon, Saint-Jean à droite
avant la révolution puis Saint-Laurent et à gauche Notre-Dame-des-Victoires",
- toutes les fenêtres de l'édifice ont reçu des vitraux (cinq). A la différence
de ceux qui existaient au XIIème siècle et dont seuls des fragments de
teinte bleue ont été retrouvés, ce sont ici de véritables œuvres d'art
qui ont été réalisées en fonction de l'édifice. Chaque vitrail est unique.
A cette liste déjà longue, il faut ajouter la réfection et la mise en
valeur des fresques, et pour finir la mise en place, par la municipalité,
d'un éclairage adéquat.
Extraits de "L'église romane de Neuvy-Pailloux (36), par Didier Dubant, Journal d'une restauration".